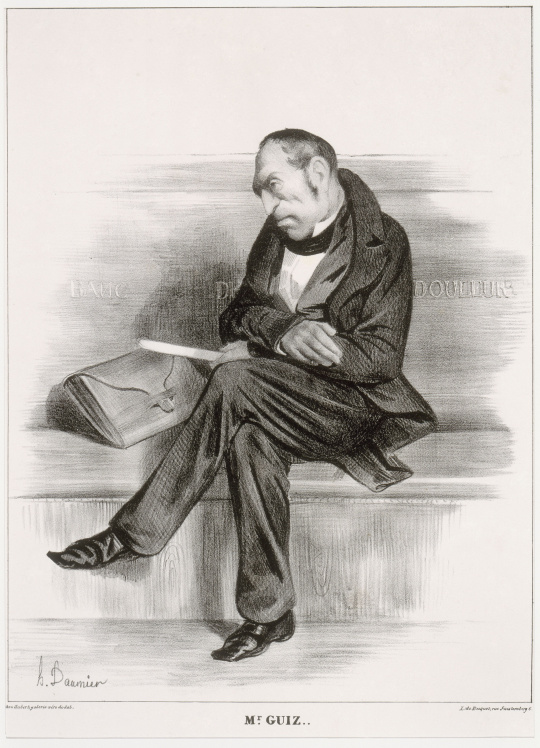Cette mise en vente d'un élément du patrimoine lexovien est l'occasion de revenir sur les fortifications de la ville de Lisieux, construites à la fin du Moyen Âge. Car la tour Sainte-Anne en est le vestige le plus visible.
La tour Sainte-Anne se situe au niveau du rond-point André Carles (combien de Lexoviens savent le nom de ce rond-point ?). Si vous préférez, elle se trouve à quelques pas du commissariat. Pour "raison personnelle", son propriétaire a décidé de vendre ce rare vestige de l'ancienne muraille qui protégeait Lisieux du XVe au XVIIIe siècle. A cette occasion, une journaliste du
Pays d'Auge m'a interviewé au téléphone pour que je lui donne quelques informations historiques. L'article est paru le 29 janvier 2016
(en voici une version partielle sans mon intervention qui se trouvait dans un encadré, non reproduit ici).
 |
| La tour Sainte-Anne est en pierre ; le dernier étage, ajouté au XVIIe, est en colombages |
J'ai décidé de revenir sur ce fait car l'article comporte plusieurs erreurs dont la responsabilité me revient en partie.
Je remets donc les choses au clair et à l'endroit.
Un chantier financé par les Lexoviens, sous l’œil des Anglais
Oui, la fortification remonte au XVe siècle, à l'époque de la guerre de Cent Ans entre Anglais et Français. Lisieux était alors une
cité quasiment sans défense. Il y a avait bien un "Fort l'Evêque" mais il ne protégeait que la cathédrale et le manoir épiscopal.
Contrairement à ce que j'ai affirmé dans l'article, le roi d'Angleterre Edouard III n'a pas incendié la ville en 1346. Il l'a évité. Quoi qu'il en soit, la guerre contre l'Angleterre et les conflits internes au royaume rendaient nécessaires la construction d'une fortification qui protégerait les Lexoviens contre les soldats ou les brigands.
La chantier a commencé à une date incertaine. En tout cas, en 1407, l'évêque Guillaume d'Estouteville avait décidé sa construction. Quand les Anglais débarquent à Touques et s'emparent de toute la Normandie en 1417-1419, la muraille n'était qu'"ébauchée" selon l'historien François Neveux. Les travaux se prolongent donc pendant l'occupation anglaise. Mais, toujours contrairement à ce qui est dit dans l'article, les Anglais ne financent pas l'édification. Ce sont les Lexoviens qui sont taxés. Bien que
les travaux avancent vite pendant l'occupation anglaise, ils ne sont pas terminés lorsque l'armée du roi de France Charles VII arrive devant Lisieux pour reprendre la ville en 1449. De toute façon, l'évêque, Thomas Basin, ne compte pas résister : il négocie la reddition de la ville à bon compte.
La fortification est probablement bouclée avant la fin du XVe siècle. La tour Sainte-Anne date sûrement de ce siècle. La journaliste du Pays d'Auge indique que c'est une porte. Non, c'est simplement une des tours qui flanquaient à intervalle régulier les remparts. Les portes, au nombre de 4 (et non 11), se trouvaient ailleurs.
Le tracé des murailles, plus exactement le tracé des fossés, reproduit grosso modo la ceinture de boulevards qui entoure aujourd'hui le centre-ville (boulevard Jeanne d'Arc, boulevard Saint-Anne, boulevard Carnot, et le bien nommé quai des remparts).
Lisieux se libère de ses fortifications
A la lecture de l'article, je constate que je me suis fait mal comprendre sur la disparition de cette fortification. Le sujet est, je le concède, difficile pour une journaliste qui travaille depuis peu à Lisieux. J'aurais dû être plus clair ou répéter. Nommé à Lisieux en 1676,
l'évêque Léonor II de Matignon fait donner les premiers coups de pioche. Il a besoin d'agrandir ses jardins - l'actuel jardin public en est une relique - et le rempart lui bouche la perspective de son palais. Les habitants se plaignent de cette brèche dans le dispositif de fortification puis, ils s'en accommodent. En effet, le spectre des invasions anglaises s'évanouit. La guerre se fait désormais aux frontières du royaume de France. Ça fait plusieurs générations que les Lexoviens n'ont pas entendu le moindre coup de canon ennemi. De plus ce rempart corsète le développement démographique et économique de Lisieux. Bref,
il gêne et ne sert plus à grand chose. Le démantèlement des remparts et le remplissage des fossés commencent avant la Révolution. Je pense, à vérifier, qu'en 1820, il ne reste presque plus de tours et de murs (voir ce
plan sur la site de la bibliothèque électronique de Lisieux). Aujourd'hui, à ma connaissance, subsistent la tour Sainte-Anne, la tour Lambert (quai des remparts) et des éléments de la porte de Caen (au bas de la rue Henry Chéron).
Voici ce que j'aurais aimé dire au téléphone à la presse. Merci à la journaliste du
Pays d'Auge, Aurore Coué, de m'avoir interrogé sur le sujet en dépit de nos incompréhensions et de mes erreurs. Le sujet me passionne. D'ailleurs un chapitre de mon livre sera consacré aux fortifications de Lisieux et à l'occupation anglaise mais il n'est pas encore rédigé.